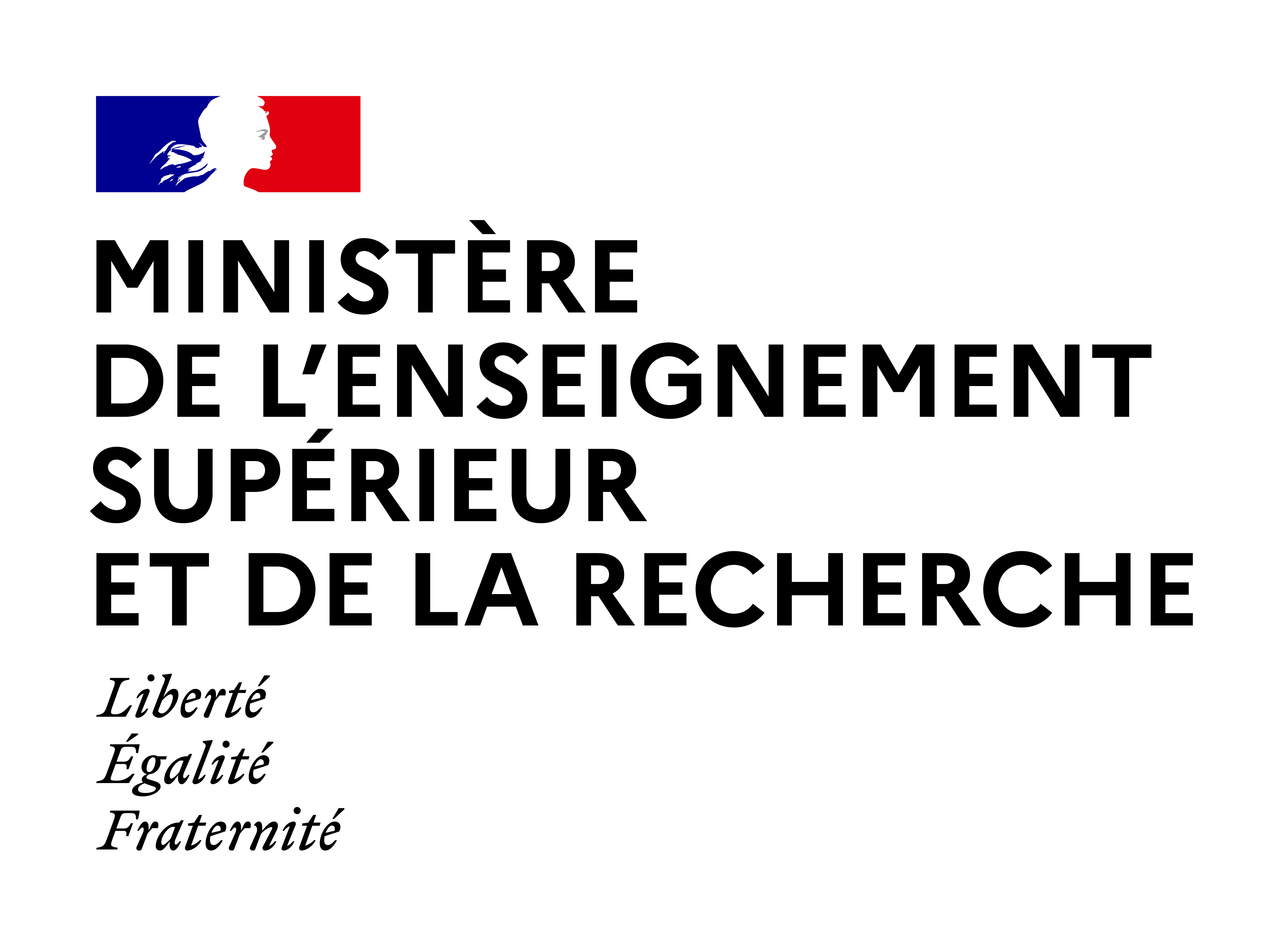bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
CHSCT du MESR
Orientations stratégiques - année universitaire 2015-2016
nor : MENH1500504X
Note du 8-7-2015
MENESR - DGRH C1-3
Les orientations stratégiques pour l'année 2015-2016 s'inscrivent dans le prolongement des axes définis pour l'année 2014-2015. Ces axes sont développés à partir des observations portées dans le rapport annuel faisant le bilan pour l'année 2014 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans les établissements relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ces orientations stratégiques constituent des priorités nationales que chaque établissement doit adapter dans son programme annuel de prévention. Le MENESR sera très attentif à leur mise en œuvre dans chaque établissement.
Ces orientations stratégiques sont articulées autour de 3 axes principaux :
Axe 1 - Évaluer les dispositifs santé et sécurité au travail afin de mieux identifier les marges de progrès et les rendre plus performants.
Axe 2 - Renforcer les services de médecine de prévention.
Axe 3 - Prévenir les risques professionnels.
Chacun des axes est complété par des mesures d'accompagnement élaborées par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour faciliter les mesures de prévention dans les établissements.
Ces orientations stratégiques ont été débattues et adoptées en CHSCT MESR lors de la séance du 8 juillet 2015.
Axe 1 - Évaluer les dispositifs santé et sécurité au travail afin de mieux identifier les marges de progrès et les rendre plus performant.
Au niveau des établissements, il convient d'améliorer l'évaluation de l'ensemble du dispositif santé et sécurité au travail (SST).
Cette évaluation doit permettre d'identifier dans chaque établissement des axes de progrès prioritaires.
Le chef d'établissement s'assurera que cette évaluation sera accompagnée d'une information à destination des directeurs de laboratoires et des responsables de services afin de les doter d'un tableau de bord les informant des éléments qui relèvent de leur responsabilité.
Dans le cadre de cette évaluation, une attention particulière sera portée sur :
- l'organisation de la prévention ;
- la qualité du dialogue social et le fonctionnement du CHSCT et du CT dans l'établissement ;
- la démarche de prévention basée sur l'évaluation des risques ;
- la qualité et mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- la programmation des actions de prévention ;
- l'information et la formation des agents ;
- le suivi médical des agents ;
- les outils de suivi de la politique de prévention.
Le chef d'établissement doit donner toutes facilités en temps et moyens matériels aux représentants du personnel au CHSCT pour l'accomplissement de leurs missions. De plus, communication doit être donnée aux représentants du personnel de toutes informations, pièces et documents utiles. À ce titre, le chef d'établissement, président du CHSCT, présente annuellement à ces derniers le rapport faisant le bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail qui reprendra a minima les données de l'évaluation du dispositif SST. Il veillera à ce que le programme annuel d'actions de prévention vienne compléter ce document de façon détaillée. L'ensemble de ces documents, accompagnés de l'avis du CHSCT, sera communiqué au comité technique ainsi qu'au conseil d'administration.
Majoritairement les chefs d'établissement ont nommé un conseiller de prévention, professionnel de la sécurité, voire créé un service hygiène et sécurité pour la moitié d'entre eux. Lorsque cela n'est pas encore le cas, le conseiller de prévention doit être directement rattaché au chef d'établissement.
Les chefs d'établissement ont constitué un important réseau d'assistants de prévention, pour lesquels une lettre de cadrage doit être établie selon le modèle type présenté dans l'annexe du guide juridique édité par la DGAFP en avril 2015 sur le site suivant :
Ce réseau doit être réuni plus régulièrement pour mettre en synergie les compétences des différents acteurs et mettre en cohérence l'évaluation des risques dans chaque unité de travail de l'établissement.
Accompagnement du ministère
Dans le cadre d'une politique nationale harmonisée, le ministère élaborera un document d'évaluation des dispositifs de santé et de sécurité au travail. Ce document sera conçu comme une aide aux établissements pour améliorer leur dispositif de prévention des risques professionnels sur la base d'un diagnostic. Une fois complété par les établissements, il sera transmis au ministère après avis de leur propre CHSCT.
Une extraction de ces recommandations présentées dans ce document servira de tableau de bord à destination des directeurs de laboratoires et des responsables de services.
À l'occasion des échanges précontractuels, le ministère prendra connaissance des documents réglementaires (rapports annuels faisant bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, programme annuel de prévention accompagnés des avis du CHSCT de l'établissement). Les actions identifiées dans le cadre de ces échanges feront l'objet d'un suivi régulier (jalons).
Axe 2 - Renforcer les services de médecine de prévention
La dynamique créée par le fonctionnement des CHSCT doit être complétée par un développement de l'offre de médecine de prévention en direction des agents de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les chefs des établissements, où il n'existe pas encore une offre suffisante de médecine de prévention, mettront tout en œuvre pour garantir un suivi médical à leurs agents à partir des différentes possibilités réglementaires.
Ils enrichiront l'offre de médecine pour proposer ce suivi à tous les agents quels que soient leur lieu d'exercice et la nature de leur activité.
Le recours à une médecine de prévention externalisée doit être exceptionnel et réservé aux établissements ou services de faible effectif. Dans ce cas, la convention d'externalisation devra inclure le tiers-temps règlementaire et la nécessité d'une lettre de mission.
Ils renforceront le service, grâce à la mise en place effective des postes de médecins collaborateurs et de la pluridisciplinarité, sous la coordination du médecin de prévention :
Ils favoriseront le recrutement de nouveaux personnels médicaux et para-médicaux :
- personnels médicaux : Les établissements communiqueront, pour faire connaître les possibilités d'embauche offertes, en développant l'accueil en stage de médecins en formation ou de médecins collaborateurs quand cette possibilité sera effective en droit ;
- infirmiers formés en santé au travail ;
- psychologues du travail ;
- ergonomes.
Les chefs d'établissement donneront aux services les moyens nécessaires en secrétariat.
Le chef d'établissement et le médecin de prévention, en liaison avec le CHSCT, définiront un pilotage de la médecine de prévention à partir des priorités suivantes :
- porter une attention et un effort particuliers à la surveillance médicale particulière (SMP), qui demande encore à être mieux cernée (risques d'exposition professionnelle, état de santé, pathologie particulière). C'est la raison pour laquelle il convient de renforcer le travail de concertation entre les services de ressources humaines et les services de médecine de prévention et obtenir entre autres la liste des agents relevant de la SMP ;
- développer les actions en milieu de travail en lien avec le conseiller de prévention, les assistants de prévention et/ou les autres acteurs de la prévention (membres du CHSCT, représentants du personnel), le tout en s'appuyant sur les rapports de visite des inspecteurs santé et sécurité au travail rattachés à l'IGAENR ;
- prévenir les RPS : Les médecins de prévention, grâce au recrutement de psychologues formés en santé au travail, et placés sous leur responsabilité, pourront développer la prévention.
Axe 3 - Prévenir les risques professionnels
Axe 3.1 - Prévention des risques psychosociaux
Cet axe de la prévention s'inscrit dans la mise en œuvre au sein du ministère de l'accord cadre relatif aux risques psycho-sociaux (RPS) dans la fonction publique du 22 octobre 2013 et des circulaires du 20 mars et 20 mai 2014.
Si une majorité de CHSCT débattent de la prévention primaire en abordant l'organisation du travail et les modalités de management, encore peu d'établissements développent des actions dans leur programme annuel de prévention et encore moins un plan d'action spécifique pour la prévention des risques psychosociaux. Cette situation est d'autant plus regrettable si on la compare aux objectifs définis dans l'accord cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des RPS dans la fonction publique.
Un travail important a été initié dans de nombreux établissements pour la mise en place d'un dispositif de prévention tertiaire autour de la prise en charge des agents en souffrance au travail.
À ce titre, les CHSCT doivent être saisis en amont des questions pouvant avoir des conséquences sur la santé des agents, notamment dans le cas de projets d'aménagements importants susceptibles de modifier les modes d'organisation du travail (travaux, réorganisation ou restructuration de service ou de laboratoire, fusion d'établissement...).
Des groupes de travail issus du CHSCT pourront être mis en place. Ils auront pour tâche de proposer, sur la base du diagnostic obligatoire, des actions de prévention primaire et secondaire.
L'intégration de la prévention des RPS dans les documents uniques d'évaluation des risques sera un objectif prioritaire.
Des outils d'accompagnement établis dans le cadre du CHSCT ministériel seront diffusés après validation.
Axe 3.2 - Prévention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques
Dans le cadre de la prévention de la pénibilité au travail, les établissements s'attacheront à mieux identifier les facteurs de risques à l'origine des troubles musculo-squelettiques (TMS). Ils devront dresser la liste des personnels exposés à ces risques.
Un plan d'action spécifique, réalisé à partir d'un diagnostic sera intégré dans les programmes annuels d'actions de prévention.
Axe 3.3 - Prévention des risques liés aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Les établissements n'ont pas progressé dans la prise en compte des risques liés à l'utilisation des produits et des animaux, malgré le rappel fait dans les plans de prévention des années antérieures.
Les établissements doivent dresser par unité de travail la liste des personnels exposés aux produits présentant un danger pour la santé et établir les fiches individuelles de prévention des expositions, afin de mettre en œuvre les mesures de prévention spécifiques à ces risques et permettre au médecin de prévention de mettre en place la surveillance médicale particulière des personnels concernés. Il convient d'avoir une attention particulière à la traçabilité des expositions tout au long de la carrière des agents, notamment dans le cadre de l'application du décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical post professionnel des agents de l'État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Axe 3.4 - Prévention des risques liés aux risques émergents
Le développement des activités de recherche sur des champs novateurs entraine l'apparition de nouveaux risques parmi lesquels figurent l'utilisation de nanomatériaux, l'usage généralisé de lasers puissants.
Afin d'anticiper la gestion de ces risques et d'intégrer la prévention dans le développement des activités de recherche, chaque établissement fera un recensement de l'utilisation des nanomatériaux dans chaque unité de recherche ou d'enseignement.
Il conviendra également de former des référents techniques sur les deux thématiques citées ci-dessus. Les formations suivies par ces agents devront leur permettre de proposer des actions concrètes de prévention adaptées aux activités de recherche. Dans un souci de qualité des compétences acquises, ces formations devront permettre aux référents d'accéder à une certification.
Accompagnement du ministère
Sur l'ensemble des thématiques déclinées dans l'axe 3, le ministère se rapprochera d'organismes nationaux reconnus afin de définir un cadre d'intervention harmonisé ainsi que les conditions de mise à disposition des établissements de ressources, notamment dans le cadre de la réalisation de diagnostics, d'actions de formations ainsi que d'une veille informative et juridique.
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche