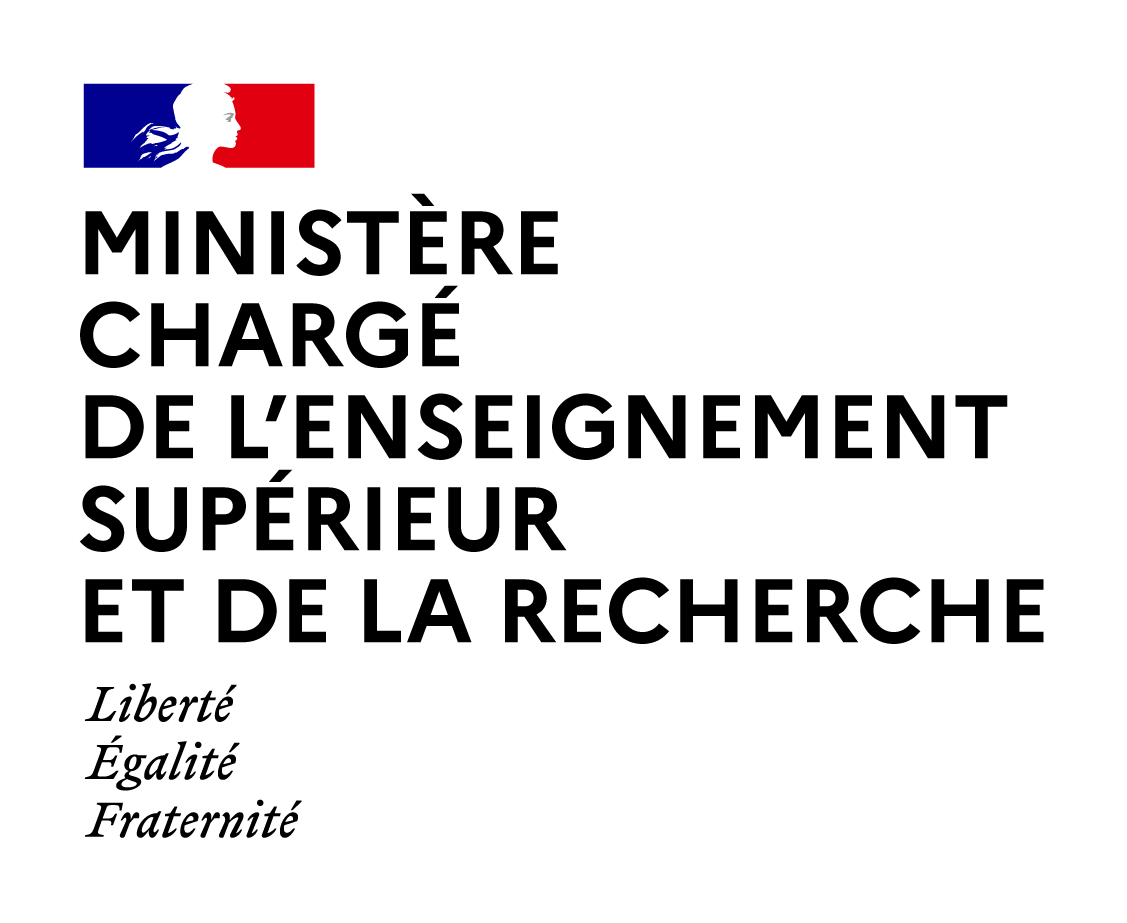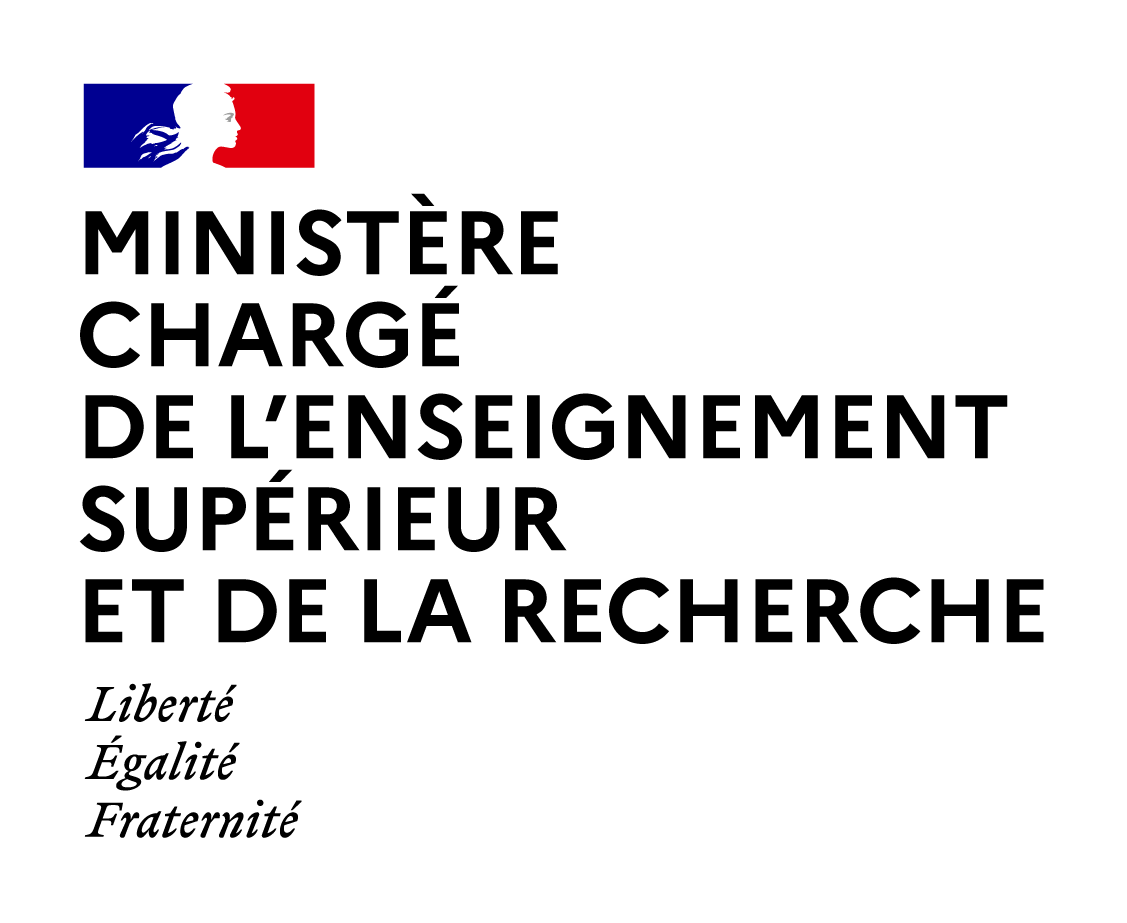Sommaire
La tradition de l'apophtegme dans l'Antiquité / Françoise Frazier
Date de création :
02.02.2012Auteur(s) :
Françoise FRAZIERPrésentation
Informations pratiques
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs. Tous droits réservés à l'Université Toulouse 2-Le Mirail et aux auteurs
Description de la ressource
Résumé
La tradition de l'apophtegme dans l'Antiquité / Françoise Frazier. In journées d'études "Usages et enjeux de l'apophtegme dans les littératures européennes des XVIe et XVIIe siècles", organisées par l'équipe "Littérature et Herméneutique" du laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (ELH-PLH) à Université de Toulouse-Le Mirail, les 2 et 3 février 2012. Plus qu'à une « tradition de l'apophtegme », on a affaire avec l'apophtegme à un des éléments d'une riche tradition sapientielle et historique, orale dans ses origines. Les œuvres écrites portant ce titre se limitent aux deux recueils transmis dans le corpus de Plutarque et au grand corpus des Apophtegmes des Pères, constitués à partir du IIIe s. apr. J.-C. De la difficulté à le cerner, héritée par l'époque moderne, témoignent à la fois la préface de Nicolas Perrot d'Ablancourt et les traductions multiples collationnées par H. Estienne, qui serviront de point de départ à un exposé dont une des visées est précisément de les expliquer. Ce flou demeure d'ailleurs aussi bien dans les encyclopédies que dans les études savantes contemporaines et le recours à l'étymologie n'apporte que peu de chose. C'est l'usage qu'il faut scruter et les qualités qui étaient associées dans l'esprit des Anciens à la notion d'apophtegme. Un premier regard sur les traités rhétoriques montre qu'il n'a jamais constitué une notion technique. Deux aspects, qui semblent correspondre grossièrement aux apophtegmes des Sages d'un côté, aux mots des hommes d'État de l'autre, peuvent être considérés. Lorsqu'il est question des premiers, l'accent est mis sur la concision, la concentration du sens qui en fait des germes de réflexion ; les seconds, qui posent aussi le problème du "mot d'esprit", apparemment privilégié par les Latins, ont une dimension éthique, révélant et formant à la fois le caractère. Ils ramènent aux Apophtegmes de Plutarque et à la dédicace à Trajan qui prétend exploiter derechef la concentration et la valeur séminale du mot, opposé à l'action, dont le résultat dépend pour partie de facteurs extérieurs et contingents.
"Domaine(s)" et indice(s) Dewey
- Critique et histoire de la littérature de langue française (études stylistiques et thématiques...) (840.9)
Domaine(s)
- Lettres classiques
- Littérature française et de langue française
- Littérature moderne et contemporaine
Intervenants, édition et diffusion
Intervenants
Édition
- Université Toulouse II-Le Mirail
Diffusion
Document(s) annexe(s)
- Cette ressource fait partie de
Fiche technique
- LOMv1.0
- LOMFRv1.0
- Voir la fiche XML