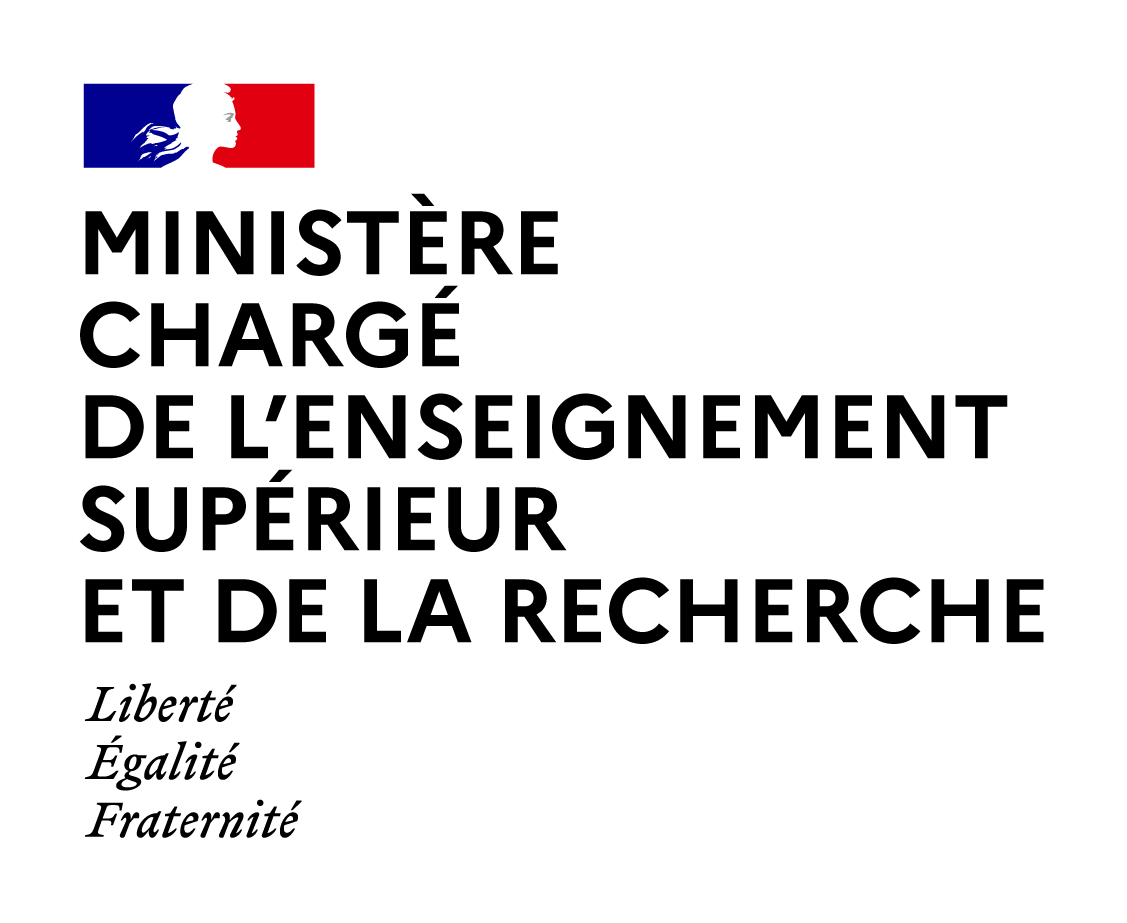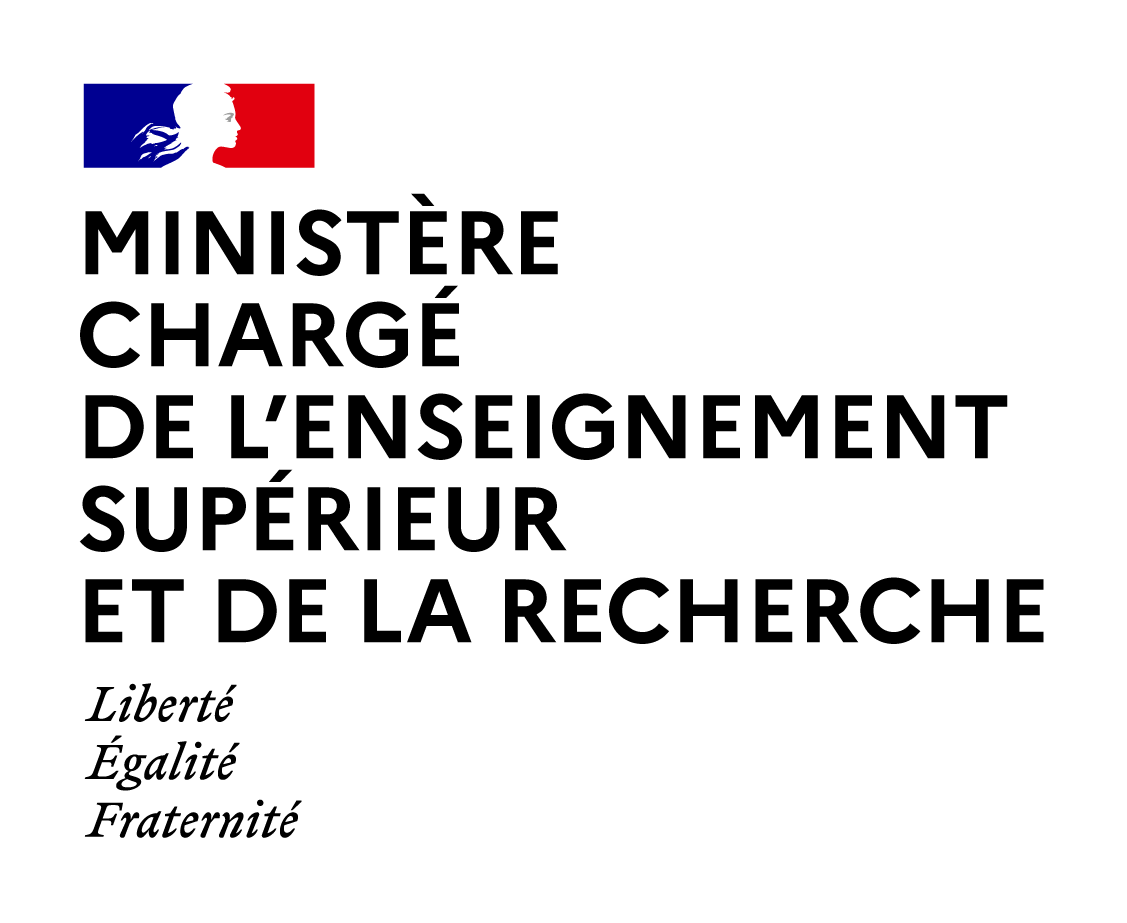Sommaire
Les premiers imitateurs de Diogène de Laërce au XVIe siècle / Michail Bitzilekis
Date de création :
02.02.2012Auteur(s) :
Michail BITZILEKISPrésentation
Informations pratiques
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs. Tous droits réservés à l'Université Toulouse 2-Le Mirail et aux auteurs
Description de la ressource
Résumé
Les premiers imitateurs de Diogène de Laërce au XVIe siècle / Michail Bitzilekis. In journées d'études "Usages et enjeux de l'apophtegme dans les littératures européennes des XVIe et XVIIe siècles", organisées par l'équipe « Littérature et Herméneutique » du laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire (ELH-PLH) à Université de Toulouse-Le Mirail, les 2 et 3 février 2012. Le premier traducteur français de Diogène Laërce est François de Fougerolles (1601), mais il ne fut pas le premier imitateur français de Diogène. Le premier imitateur de Diogène est Guillaume Tardif. Les emprunts à Diogène faits par Guillaume Tardif sont innombrables. Pas plus que d’une étude des Ditz moraulx il ne saurait être question d’étudier en entier ce qu’il doit à Diogène. Les Ditz moraulx sont une compilation où apparaissent plusieurs sentences morales, aventures singulières et anecdotes tirées de vies des philosophes. Les premiers imitateurs de Diogène ne se contentent pas de recopier tout simplement le texte des Vies, mais ils essayent de reconstituer, de fabriquer leur propre recueil d’apophtegmes. En 1545, Gilles Corrozet publia un ouvrage intitulé Le Conseil de sept Sages de Grece qui se présente comme une biographie et un recueil d’apophtegmes des sept Sages. Cette tendance à imiter Diogène est plus évidente dans un ouvrage d’un anonyme publié en 1554. Dans cet ouvrage, nous rencontrons deux fameuses anecdotes de Thalès et de Solon, mais cette fois-ci la fidélité par rapport au texte de Diogène est plus que remarquable. Sans perdre de vue que Diogène Laërce a été traduit pour la première fois en latin vers 1472, il est certain que ces auteurs ont pu avoir accès à ce texte majeur par l’intermédiaire de la traduction latine d’Ambrogio Traversari. Guillaume Tardif, actif vers 1475, n’a pas pu connaître d'autre édition que celle de Traversari. La lecture possible d’un manuscrit est plutôt à exclure vu que les premiers manuscrits qui arrivent de Constantinople sont à la possession des érudits et collectionneurs. Cette hypothèse est confirmée par Charles Fontaine dans l’introduction de son ouvrage Les dicts des sept Sages quand il se réfère à la « prose latine » des Vies.
"Domaine(s)" et indice(s) Dewey
- Critique et histoire de la littérature de langue française (études stylistiques et thématiques...) (840.9)
Domaine(s)
- Lettres classiques
- Littérature française et de langue française
- Littérature moderne et contemporaine
Intervenants, édition et diffusion
Intervenants
Édition
- Université Toulouse II-Le Mirail
Diffusion
Document(s) annexe(s)
- Cette ressource fait partie de
Fiche technique
- LOMv1.0
- LOMFRv1.0
- Voir la fiche XML