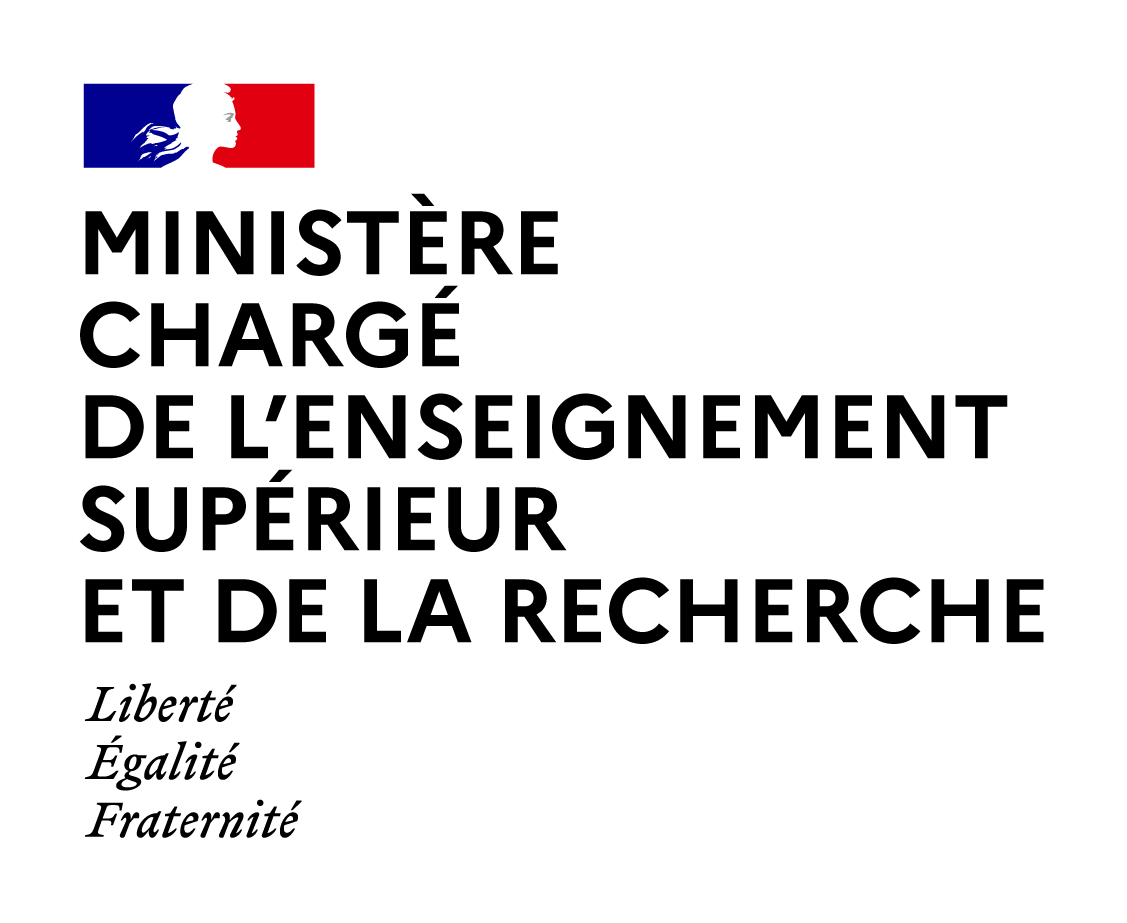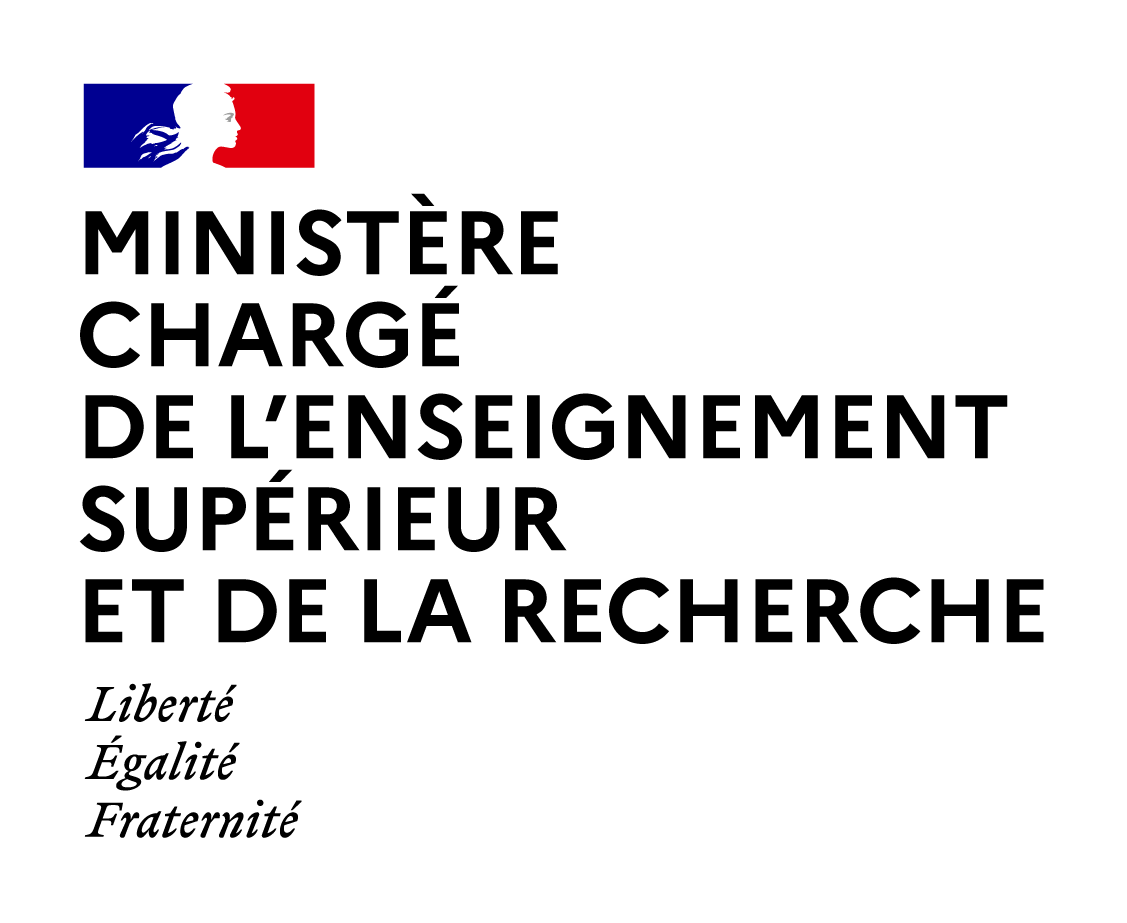Sommaire
Comment définir le régime politique chinois aujourd'hui ?
Date de création :
15.01.2003Auteur(s) :
Michel BONNINPrésentation
Informations pratiques
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs.
Description de la ressource
Résumé
Depuis le lancement des réformes, il y a plus de 20 ans, la Chine a connu de profonds changements économiques et sociaux. Elle s'est modernisée, son économie a connu des taux de croissance très rapides et fonctionne partiellement sur un mode « capitaliste ». Pourtant, de façon surprenante, son régime politique est resté fondamentalement le même. Le Parti communiste dirige toujours la Chine, selon des méthodes héritées de Lénine, Staline et Mao Zedong, mais adaptées par Deng Xiaoping, à la fin des années 1970. Pour des raisons d'efficacité économique, le pouvoir a alors laissé plus d'initiative aux acteurs sociaux et, n'ayant plus la prétention utopique de former « l'homme nouveau », il s'est en partie retiré de la vie privée des citoyens. Il a également accordé un peu plus de liberté aux intellectuels, aux écrivains et aux artistes. Il a cependant conservé l'essentiel des institutions existantes de contrôle des idées, des personnes et des groupes : propagande, censure, certificat de résidence, dossier personnel, prise en charge complète de chacun par son unité de travail, etc. Si le pouvoir ne cherche plus à surveiller ce que chacun pense ou dit en privé, s'il laisse une assez grande marge de manoeuvre aux entrepreneurs privés, il continue à vouloir contrôler totalement l'espace public. Se concentrant sur l'essentiel, il continue à régner sur l'information, la communication et, surtout, l'organisation politique et sociale. Son refus d'accepter l'existence de toute organisation sociale autonome (association, syndicat, église, parti politique ou autre) le distingue nettement d'un banal autoritarisme. On pourrait définir ce type de pouvoir comme un totalitarisme « replié ». En effet, s'il laisse subsister des zones d'indifférence dans lesquelles sa présence ne se fait pas directement sentir, c'est qu'il s'est replié sur un noyau dur du totalitarisme (symbolisé par les Quatre principes fondamentaux de Deng Xiaoping). À partir de ce noyau, l'État-Parti peut à tout moment, si besoin est, se déplier et frapper toute personne ou toute force sociale considérée comme dangereuse. C'est ce qu'a montré, par exemple, la répression de la « secte » Falungong. La croissance économique de type capitaliste va-t-elle nécessairement entraîner la Chine vers la démocratie ? Certes, il existe une aspiration à plus de démocratie dans la population, mais, dans la mesure où le Parti communiste interdit l'existence de la moindre organisation autonome, il est difficile d'imaginer quelle force sociale pourrait être à même de contraindre le pouvoir à prendre cette direction. La question est donc plutôt de savoir si le Parti lui-même (ou une fraction importante en son sein) voudra faire évoluer le système politique pour le rendre mieux adapté à l'évolution économique et sociale ou, simplement, à ses propres intérêts. Des transformations sont évidemment possibles, mais, il n'est pas du tout certain qu'elles aillent dans le sens de la démocratie. La classe dirigeante s'est énormément enrichie et n'a certainement aucun désir de partager ses privilèges avec les laissés-pour-compte de la réforme, ni de se soumettre à la surveillance de contre-pouvoirs. Elle a su, par une habile utilisation de la carotte et du bâton, neutraliser la classe intellectuelle des villes. Un éventuel abandon du dogme communiste, ou une profonde modification, ne déboucherait donc pas nécessairement sur une démocratisation. La priorité donnée au nationalisme comme moyen de légitimation, les liens intimes entre le Parti et une couche de grands capitalistes issus du sérail, ainsi que la répression des intellectuels libéraux et des activistes syndicalistes sont des traits que l'on a connus dans d'autres systèmes totalitaires, de type fasciste. Une nouvelle métamorphose du totalitarisme n'est donc pas exclue.
"Domaine(s)" et indice(s) Dewey
- Science politique (320)
Domaine(s)
- Sciences politiques
Intervenants, édition et diffusion
Document(s) annexe(s)
- Cette ressource fait partie de
Fiche technique
- LOMv1.0
- LOMFRv1.0
- Voir la fiche XML