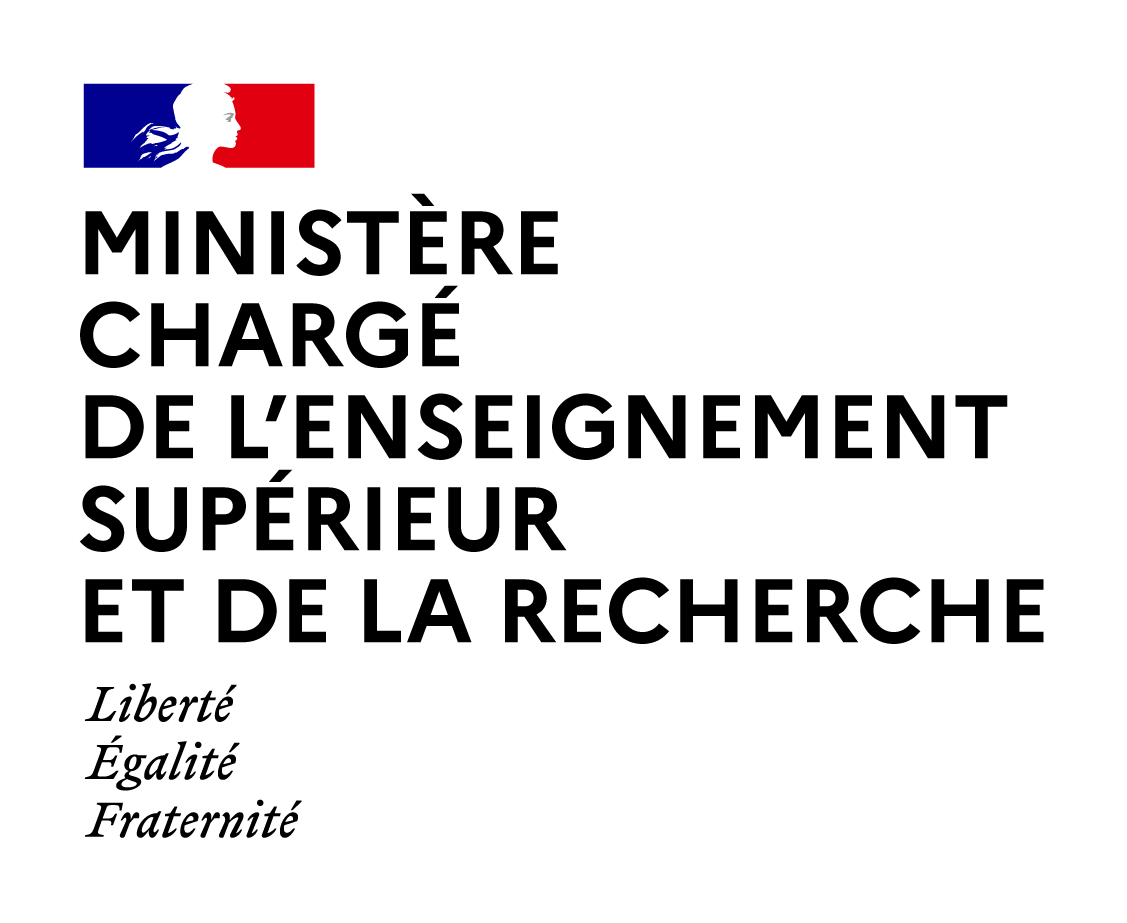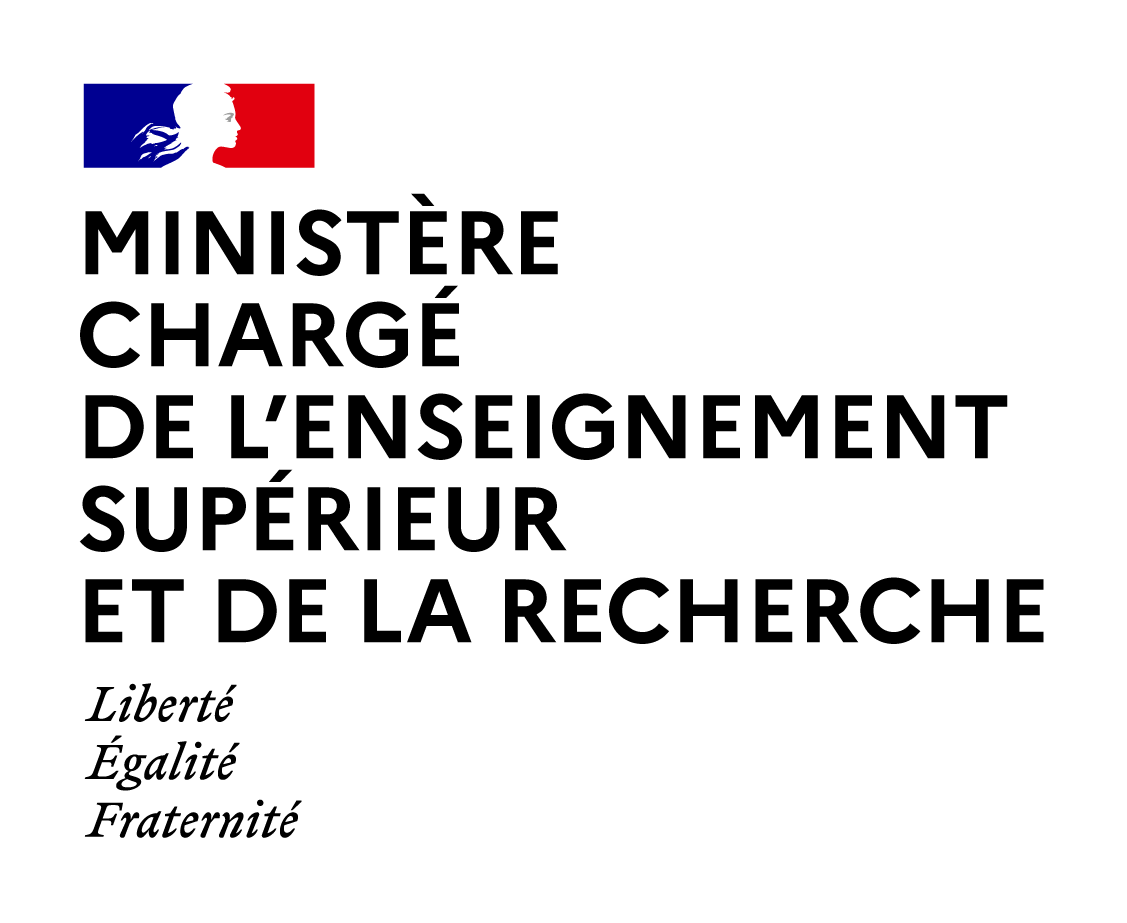Sommaire
Françoise Blanc lit le résumé de la conférence "La réception de l’oeuvre de Marcel Breuer à Bayonne" de Bruno Fayolle Lussac, historien de l’architecture
Date de création :
18.10.2019Présentation
Informations pratiques
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs.
Description de la ressource
Résumé
De la ZUP de Sainte-Croix de 1963 à la résidence Breuer des Hauts de Bayonne des années 2000. La nomination de Marcel Breuer comme architecte en chef de la ZUP de Bayonne est due à sa notoriété (siège de l’UNESCO) et à son réseau de relations et notamment à Éric et Sylvie Boissonnas, les promoteurs de Flaine, depuis leur rencontre dans le village de New Canaan aux USA dans les années 1950. La construction de la ZUP a permis à Breuer de mettre en oeuvre des idées architecturales et des techniques parfois innovantes (architecture de béton, massive et sculptée en façade, procédés de préfabrication, double orientation des cellules d’habitation en duplex). L’attention minutieuse portée aux détails dans la construction s’avèrera déterminante dans les choix de réhabilitation de la ZUP. Le plan masse prévoit une longue ligne sinueuse de dixhuit grands blocs de logements de douze étages en rebord d’un plateau, dominant l’ensemble des équipements et services d’un grand quartier en contrebas. L’étalement de la réalisation de 1966 à 1968, puis de 1969 à 1970, comme le décalage entre la construction des immeubles de logements et des équipements conduiront à la révision du projet initial de la ZUP en 1972 : sept blocs de logements auront été finalement réalisés. Dès les années 1970, la ZUP, perçue sur le plan local plutôt négativement, a fait l’objet de plusieurs programmes de réhabilitation. L’année 2009 marque un tournant de sa perception à Bayonne (l’année Breuer). L’inauguration des « Hauts de Bayonne » en 2013, mettant en valeur les immeubles de « la résidence Breuer », comme l’inscription de la « Cité de Sainte-Croix » au titre du label architecture XXè en 2014 (site remarquable, 2018) renforcent l’attractivité d’une ville labellisée d’art et d’histoire qui inscrit par ce biais dans sa mémoire le nom et une oeuvre ainsi revalorisée de l’un des grands architectes du XXè siècle dont on évoque maintenant la formation au Bauhaus. Bruno Fayolle Lussac est historien de l’architecture et archéologue, professeur honoraire de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage (ENSAP) de Bordeaux depuis 2006 - Membre des commissions du patrimoine (CRPS et CRPA) de la région Aquitaine depuis 1988 et Président du Collège régional du patrimoine et des sites (1988-1997) - Co-fondateur de l’observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine (1997) et membre actif jusqu’en 2005. Responsable scientifique (1986-2004) du certificat post-diplôme d’architecture « Patrimoine, ville et développement » et de l’équipe de recherche « Production de la Ville et Patrimoine » (PVP) des ENSA de Bordeaux et Toulouse (1991-2004) - Chercheur associé à l’UMR du CNRS AUSSER-Paris Belleville depuis 2004.
"Domaine(s)" et indice(s) Dewey
- Philsophie et théories de l'architecture (720)
- architecture, design (720)
Domaine(s)
- Architecture, Art du paysage
- Architecture, Art du paysage
Document(s) annexe(s)
- Cette ressource fait partie de
Fiche technique
- LOMv1.0
- LOMFRv1.0
- Voir la fiche XML