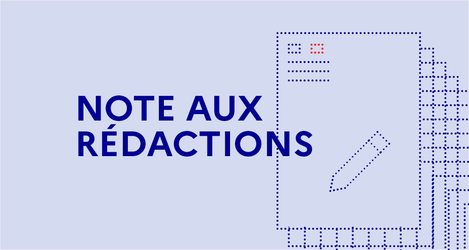Un dernier mot, à l’issue d’une journée qui aura été longue, sans doute, mais qui nous aura aussi permis de vivre ensemble un petit moment d’histoire.
Ce soir, je veux d’abord vous dire que je suis très heureuse que le Premier ministre ait choisi, pour s’adresser à la communauté scientifique et annoncer la préparation d’une loi de programmation pour la recherche, de s’exprimer devant plus de 1000 directeurs des unités de recherche du C.N.R.S. et de ses partenaires. C’est le fruit de mois de travail.
C’était une excellente manière de commencer les célébrations du 80e anniversaire du premier organisme de recherche en Europe. Le C.N.R.S. occupe une place particulière dans notre pays, bien sûr, son nom est connu de tous ou presque, il est synonyme d’excellence scientifique et de dévouement à la cause du savoir. Et à l’échelle internationale, il est un des étendards de la recherche française, d’une recherche qui est portée par l’organisme, bien sûr, mais également par les universités et les écoles.
Mais c’était aussi et peut-être même surtout l’occasion de dire notre reconnaissance collective à ceux qui font vivre au quotidien notre recherche, qui ont accepté de prendre des responsabilités dans l’intérêt de tous, de consacrer du temps à cette tâche essentielle, mais souvent chronophage et parfois aride qu’est la direction d’un laboratoire.
Certains d’entre vous, j’en suis certaine, ne mesuraient pas totalement ce à quoi ils s’engageaient en acceptant de devenir D.U. pour 5 années. Et en l’espace d’une ou deux décennies, il est vrai que le rôle de D.U. a beaucoup évolué, au point de devenir un métier – un métier que l’on n’exerce pas toute sa vie, un métier qui est parfois éloigné de votre vocation scientifique, mais un métier essentiel, indispensable. Et je veux saluer l’initiative prise, depuis plusieurs années, par le C.N.R.S. et par la C.P.U., de réunir chaque année les nouveaux directeurs d’unité pour les accompagner.
La recherche est une aventure collective : nous le savons tous. Mais au-delà de la formule, ce collectif, il faut le faire vivre au quotidien. Il faut le faire vivre scientifiquement et c’est le premier rôle du D.U.. Mais il faut aussi accompagner, jour après jour, une collectivité humaine, avec ses interrogations, ses moments de tension, ses contraintes de gestion. Comme il faut interagir avec les tutelles – puisqu’il se trouve que dans notre univers commun, "tutelle" prend quasiment toujours un pluriel – et un pluriel particulièrement prolixe. Je sais ce que cela signifie de sacrifices... vos projets, votre vie personnelle, votre carrière.
Avant toute chose, dans le prolongement des propos tenus par le Premier ministre ce matin, je voudrais donc vous dire toute ma reconnaissance : ma reconnaissance de ministre, bien sûr, mais aussi de scientifique qui a exercé et qui exerce des responsabilités, qui en connaît les joies, mais aussi le poids.
Avec Antoine Petit et l’ensemble du collège de direction du C.N.R.S., avec les présidents d’université et les directeurs d’école qui ont été présents tout au long de cette journée, nous avons une responsabilité : celle de faire ce qui est en notre pouvoir pour vous rendre la tâche un peu plus facile. Cela suppose des moyens, bien sûr, et vous avez compris qu’ils seront au rendez-vous. Mais au-delà des moyens, nous devons agir pour simplifier les choses dans un système de recherche qui reste marqué par une grande complexité.
La mixité est une chance, nous le savons tous. Mais on peut cultiver la mixité scientifique sans cultiver la complexité administrative. Pendant longtemps, nous avons fait et l’un et l’autre. Le moment est venu est de changer les choses. C’est le sens du travail qu’Antoine Petit a engagé avec les partenaires du C.N.R.S. pour conduire ensemble une réflexion sur le sens même de la tutelle et réduire leur nombre chaque fois que cela fait sens.
C’est un exercice un peu aride, bien sûr, un exercice qui vient parfois bousculer l’histoire et l’identité d’un laboratoire, mais qui est nécessaire, parce qu’il permet d’alléger les formalités administratives, bien sûr, mais aussi et surtout de redonner toute sa signification à l’engagement des institutions.
Partager la tutelle d’un laboratoire, c’est partager une stratégie scientifique, c’est mettre en commun des moyens, c’est s’engager au côté d’autres institutions dans la mise en œuvre d’un projet qui ne peut être que partagé, c’est faire vivre cette chose singulière qu’est une unité mixte de recherche, entité qui est la brique de base du système de recherche.
Il n’y a de partenariat qu’équilibré : nous le savons tous.
Et si cette idée de partenariat est essentielle, c’est qu’elle nous oblige à aller au-delà des oppositions tranchées qui ont trop longtemps structuré le débat autour de l’organisation et le financement de la recherche. Je pense à l’opposition entre organismes de recherche d’une part et universités, bien sûr, mais l’on pourrait dire la même chose, dans un autre registre, de l’opposition entre recherche de base et recherche finalisée ou entre financement récurrent et appels à projet.
Nous nous sommes trop longtemps laissé enfermer dans ces éternels débats. Nous avons besoin tout à la fois d’universités fortes et autonomes, qui affichent leur identité d’université de recherche ou qui cultivent leur signature dans tel et tel domaine, tout comme nous avons besoin d’organismes de recherche. Avoir un C.N.R.S., un C.E.A., un Inserm, INRA ou INRIA, par exemple, c’est une chance et c’est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur les organismes pour coordonner les programmes prioritaires de recherche que nous avons lancés pour organiser notre réponse collective aux grands défis qui s’offrent à nous. Et ces programmes, ils engagent évidemment les universités et les écoles autant que les organismes. Ils engagent en réalité ceux, hommes et femmes, qui font la science.
A force d’avoir cultivé ces oppositions, nous avons fini par installer l’idée que parler de recherche dans le débat public, c’est évoquer des questions d’organisation et de financement. Mais c’est d’abord de science que nous devrions parler ! De cette passion si particulière qui nous anime, celle d’essayer de comprendre des phénomènes qui nous échappent, celle qui nous fait passer des heures sur notre paillasse à recommencer cent fois une manip’ ou à rester au laboratoire à des heures tardives pour finir un papier. Parler de recherche, cela devrait d’abord dire, partager, cette joie spéciale que l’on ressent quand on finit par saisir, caractériser et prouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous échappait jusque-là et qui devient si simple lorsque l’on parvient enfin à le décrire et à l’expliquer.
Et si j’y insiste, c’est que face aux débats qui montent, un peu partout dans le monde, sur la valeur de la recherche, sur le statut de la vérité scientifique, nous devons répondre non pas en invoquant une autorité abstraite, mais en rappelant ce qu’est la science : « un long effort, souvent pénible », pour utiliser les mots de Maurice Allais, pour comprendre les choses telles qu’elles se donnent dans l’expérience, dans une expérience qui est reproductible et qui est contrôlée. La science n’est pas une chose nébuleuse, elle est immergée dans la réalité : c’est ce qui fait sa force et sa valeur. Le montrer, en ouvrant les portes des laboratoires, en ne craignant pas d’expliquer, c’est la meilleure des manières de répondre au scepticisme qui monte ici et là. Et je sais que vous le faites à chaque occasion et de cela aussi je voulais vous remerciez.
Et pour un Gouvernement, faire le choix, comme l’a fait ce matin le Premier ministre, d’investir massivement dans la recherche, c’est d’abord réaffirmer une évidence : nous avons besoin de dépasser de nouvelles frontières, de comprendre de nouveaux objets, nous avons besoin d’en savoir plus sur les choses et sur nous-mêmes.
Et si j’y insiste, c’est que nous nous sommes là aussi trop longtemps perdus dans les oppositions entre recherche fondamentale et recherche finalisée. Il est temps de le dire : ce débat a vécu. On n’invente pas l’ampoule en perfectionnant la bougie, nous le savons tous. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas besoin de recherche finalisée, bien sûr et d’ailleurs on a beaucoup amélioré les ampoules. Cela veut juste dire que si nous ne repoussons pas les limites des connaissances aujourd’hui, nous n’aurons plus rien à appliquer demain.
C’est pourquoi je souhaite que le travail que nous allons engager ensemble autour de cette loi de programmation ne soit pas l’occasion de rejouer, une fois encore, la même pièce, mais au contraire, d’apporter des réponses pragmatiques aux grandes questions qui se posent à notre recherche.
Ces questions, c’est : de quoi avons-nous besoin pour rendre notre recherche plus forte, face à une concurrence internationale toujours plus intense ? Pour garantir l’attractivité des carrières scientifiques dans notre pays ? Pour favoriser la diffusion de l’innovation, que nous appelons tous de nos vœux, mais qui se fait encore trop lentement ?
Une loi de programmation pluriannuelle, ce ne sont pas seulement des moyens supplémentaires pour les laboratoires. Bien sûr, ces moyens sont indispensables. Ils seront au rendez-vous, le Premier ministre l’a dit ce matin.
C’est le principe d’une loi de programmation pluriannuelle, au sens financier du terme. C’est une première et c’est indispensable car il ne suffit pas de dire que la recherche est une priorité, que nous entrons dans une économie de connaissance et que la France entend jouer les premiers rôles. Il faut en tirer les conséquences et passer aux actes. C’est ce que le Premier ministre, fidèle à lui-même, a fait ce matin.
Mais au-delà de la question des moyens, une loi de programmation permet aussi de refonder, sur des bases solides, des bases revisitées lorsqu’il le faut, notre système de recherche. Ce sont des lois faites pour durer – pour durer cinq, dix ou quinze ans, pour durer au-delà même des investissements qu’elle prévoit. La loi "Chevènement" de 1982 comme la loi "Allègre" de 1999 ont profondément changé le visage de notre recherche – et avec le recul, au-delà de tel ou tel point particulier, elles l’ont changé en bien.
L’ambition de cette loi de programmation, c’est de faire de même et un résultat comme celui-ci ne s’atteint pas en chambre. Cette nouvelle ambition pour la recherche française, elle ne peut venir du seul ministère, loin s’en faut : il faut que les communautés s’en saisissent, il faut qu’elles nourrissent notre réflexion collective, non pas en visant à l’exhaustivité ou à la synthèse, comme l’avaient fait les états généraux ou les assises, mais pour nous permettre d’identifier ensemble des options, des pistes nouvelles et nous permettre de faire des choix.
1/ Faire des choix en matière de financement, d’abord. Cela passe par une remise à niveau de l’A.N.R., bien sûr : nous l’avons engagée, il faut la poursuivre, nous sommes encore très loin de ce qui se pratique en Allemagne, au Japon ou en Suisse. Et les taux de succès extrêmement bas que nous avons connu au cours des dernières années ont deux conséquences majeures : d’abord, ils sont profondément inefficaces, évincent de très bons projets et découragent les équipes ; et ils déforment également la vision que nous pouvons avoir des financements compétitifs. Qui dit compétitif ne dit pas hypersélectif ou loterie: le financement sur projet, c’est d’abord une manière d’associer financement et évaluation scientifique par les pairs. Et c’est aussi une manière – et ce n’est pas la seule - de permettre aux jeunes équipes de prendre leur envol et aux approches nouvelles d’être soutenues.
La question qui nous est donc posée, c’est de savoir comment garantir que les labos comme les projets seront financés au bon niveau. C’est d’organiser notre système de financement pour la simplifier, pour qu’une équipe n’ait plus à multiplier les dossiers pour conduire ses travaux. C’est de veiller à ce que la recherche de base comme la recherche finalisée puissent accéder aux financements : c’est de veiller à ce que toutes les sciences y trouvent leur place.
La question c’est aussi de savoir comment garantir que les programmes prioritaires de recherche qu’il nous faut mener pour répondre aux enjeux de notre temps disposeront des financements suffisants et seront mis en œuvre en respectant les fondamentaux de la recherche d’excellence et en produisant des résultats à la hauteur des attentes de nos concitoyens.
La question, c’est également de savoir comment garantir de la visibilité aux laboratoires : c’est de vous donner à vous, directeurs d’unité, une idée claire des financements sur lesquels vous pourrez compter sur plusieurs d’années et de reconstituer les marges de manœuvre qui vous permettront de conduire, avec l’ensemble de l’unité, une vraie politique scientifique. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, dès l’année dernière, consacrer 25 millions d’euros à la reconstitution de ces marges. Et je sais que nous devrons sans doute faire plus.
La question, c’est enfin de savoir comment garantir que les laboratoires pourront avoir accès demain à de nouveaux équipements et à des plateformes scientifiques et technologiques du meilleur niveau car ces équipements et ces plateformes font une différence nette dans la compétition mondiale : et là aussi, cela questionne notre manière de gérer et d’organiser l’accès à ces équipements – et notamment aux équipements mi-lourds, qui sont de moins en moins la propriété d’un laboratoire et de plus en plus un bien commun à l’échelle d’un campus ou d’un site.
2/ Le deuxième point de réflexion qui doit nous mobiliser, c’est l’attractivité des carrières et des emplois scientifiques. Nous sommes dans une situation très particulière : je pense au niveau des rémunérations, bien sûr, mais aussi à l’âge moyen et aux conditions de recrutement. Bien sûr, les concours de chargés de recherche ou de maîtres de conférences attirent toujours de très nombreux candidats, y compris étrangers, mais nous voyons tous que la situation n’est pas durable.
Là aussi, nous devons engager la réflexion sans nous enfermer dans des oppositions de principe – entre emploi et niveau de rémunération, entre traitement et indemnitaire, entre recrutement de chercheur et d’enseignant-chercheur et recrutement de personnels d’appui et de soutien. Regardons, comme nous y a invité le Premier ministre, ce qui se fait dans d’autres pays, non pas pour décalquer des modèles, mais pour identifier des pistes, pour voir comment recruter plus tôt nos jeunes scientifiques et comment aborder la question de la rémunération.
Je veux être très claire sur ce sujet : il ne s’agit pas, en abordant ces questions, de ressusciter de vieux projets de fusion de corps ou de reposer la question du statut d’agent public dans les E.P.S.T.. Mais en revanche, nous avons le droit – et même le devoir - de réfléchir et de travailler sur la manière dont nous reconnaissons, aux différentes étapes d’une carrière, les différentes missions des enseignants-chercheurs et des chercheurs ainsi que celles des ITA et des BIATSS. Si des solutions pragmatiques sont envisageables, explorons-les et discutons-en.
Nous avons commencé à le faire autour de la notion d’investissement pédagogique : c’est ce qui nous permettra de doubler, dès cette année, le nombre de C.R.C.T.dont peuvent bénéficier les enseignants-chercheurs et j’aurai l’occasion, dans un avenir proche, de préciser la manière dont cela se mettra en place. Nous le faisons aussi au travers de l’IUF, nous devons y penser pour les D.U. pour vous permettre de soutenir votre propre recherche par exemple.
3/ La troisième question évoquée par le Premier ministre, c’est celle de la recherche partenariale. Là aussi, nous cédons trop souvent aux oppositions faciles : nous avons besoin tout à la fois d’investissements publics et d’investissements privés, car ils ne financent pas les mêmes projets. Et là aussi, les lignes ont bougé depuis l’adoption de la loi Allègre : le C.N.R.S. et ses partenaires affichent leurs laboratoires communs avec les industriels et soutiennent fortement leurs start-up, les universités affirment une politique d’innovation à l’échelle d’un site.
Et pour autant, la surface de contact entre recherche public et recherche privée reste limitée. Ce constat ne s’explique pas seulement par la complexité de notre écosystème – y compris de notre écosystème scientifique. Mais cette complexité joue à l’évidence et il suffit de se mettre un instant dans la peau d’une P.M.E. qui a un besoin d’innovation pour s’en rendre compte.
Là aussi, nous devons déplacer les lignes et construire ensemble des réponses pragmatiques pour aller plus loin. Car nous avons la conviction que nous pouvons augmenter le financement privé de la recherche publique, sans que celle-ci ne perde rien de son âme, bien au contraire : il suffit d’aller dans une unité mixte entre le C.N.R.S. et ses partenaires et Solvay, Thalès ou Saint Gobain pour le constater. Et il ne s’agit pas de se limiter aux grands groupes mais bien de déployer une activité de projets, de chaires, de laboratoires ou d’investissement communs avec des start-ups, des P.M.E., des E.T.I. et des grands groupes.
Vous le voyez, Mesdames et Messieurs les directeurs d’unité, au-delà du nécessaire investissement que nous allons programmer, nous avons également l’occasion d’imaginer des solutions nouvelles à des questions parfois lancinantes. Nous ne trouverons pas nécessairement des solutions nouvelles pour chacune d’entre elles et le moment venu, il reviendra au Gouvernement de faire des choix.
Ces choix, je souhaite qu’ils puissent s’appuyer sur la réflexion qui aura été conduite par les trois groupes qu’évoquait le Premier ministre, ainsi que sur toutes les contributions qui leur auront été adressées par la communauté. Naturellement, les institutions joueront tout leur rôle et je sais qu’organismes, universités et écoles auront à cœur de participer à ce travail. Il n’en demeure pas moins essentiel que les différentes communautés puissent s’exprimer. Dans l’un et l’autre cas, vous avez donc un rôle essentiel à jouer.
Je terminerai donc cette trop longue conclusion par une invitation : une invitation à vous saisir, vous les directeurs d’unité, de ces questions qui engagent l’avenir de notre recherche et à contribuer à la réflexion, pour imaginer ensemble des solutions concrètes et pragmatiques.
Je sais que je peux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi.