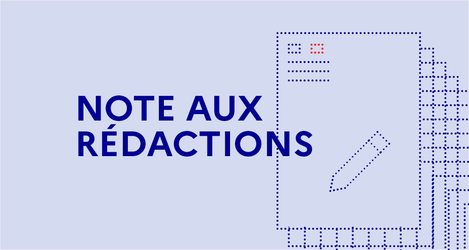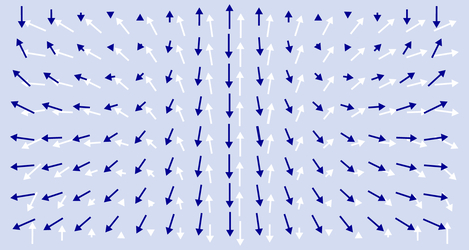SEUL LE PRONONCE FAIT FOI
Il y a 5 mois presque jour pour jour, j’ai annoncé la mise en œuvre d’un plan qui porte l’engagement de la France en faveur de la science ouverte.
La science ouverte n’est ni un courant de pensée, ni une mode, ni une posture, ni une préférence technique ou éditoriale : c’est une force qui bouscule les pratiques établies et les mentalités, un geste qui libère la dynamique de progrès par le savoir, une évidence pour quiconque veut donner à la connaissance le pouvoir de transformer le monde et de soutenir la rationalité trop souvent battue en brèche.
Constater cette évidence est une chose, en faire une réalité est autre chose. Le décloisonnement de la science se heurte à des obstacles financiers, technologiques, mais aussi culturels, qui ne pourront être surmontés sans l’engagement de toute la communauté scientifique.
C’est la raison pour laquelle je me réjouis de vous voir si nombreux, dans cette salle et en ligne, pour ces premières journées nationales de la science ouverte, dont j’ai le plaisir d’ouvrir le dernier volet aujourd’hui.
Si j’ai confiance dans notre capacité collective à remporter cette bataille culturelle, c’est parce que cette aspiration est déjà présente au sein de la communauté scientifique. Nous ne partons pas d’une page blanche, loin de là ! Et je salue d’ailleurs les récentes adhésions de nombre de nos grands organismes et opérateurs de recherche à la déclaration de DORA.
Je ne vous apprends rien en rappelant que le web a été inventé au CERN, et qu’il a été offert au monde, comme un bien commun, comme un geste de fondation de la science ouverte. Je ne vous apprends rien en rappelant que la science ouverte précède l’invention du web : les chercheurs se sont toujours envoyé des tirés à part pour partager leurs travaux avec leurs collègues. Et c’est en 1991, avant même l’apparition du web, que des physiciens ont développé un service s’appelant ArXiv, qui était la solution pratique à un problème pratique : ils voulaient échanger plus facilement, plus rapidement, plus universellement leurs articles en amont d’un circuit de publication plus lent. Puis c’est en 1995 que des chercheurs ont créé Mathdoc en France, en 1998 Scielo au Brésil, en 1999 Erudit au Canada et OpenEdition en France, en 2001 HAL en France et Open Journal Systems au Canada, en 2003 Plos aux États-Unis, etc. Toutes ces initiatives ont été celles de chercheurs qui aspiraient à des services plus modernes et plus démocratiques.
Je nous invite à remonter plus loin dans le temps : le premier numéro de la première revue scientifique paru à Paris le 5 janvier 1665 sous forme d’un bulletin de douze pages annonçait son objectif de faire connaître "ce qui se passe de nouveau dans la République des lettres", sous le nom de Journal des sçavans. Jusque-là, les savants échangeaient, avec une grande intensité, des lettres. Le Journal des sçavans regroupe ces lettres et organise leur accès plus large, plus universel.
La science ouverte, ce n’est rien d’autre que le Journal des sçavans réinventé à l’heure de l’internet!
Car il ne s’agit pas tant de créer de nouvelles règles que de répondre à une nécessité intrinsèque de la science, dont les progrès sont cumulatifs et attisés par la confrontation de savoirs issus de tous horizons. "La science veut être libre" pourrait-on dire en détournant la célèbre phrase de Stewart Brand.
Si je suis confiante, ce n’est pas seulement parce que la science ouverte s’inscrit dans le sens de l’histoire : c’est aussi parce qu’elle est essentielle à notre avenir.
Qu’est-ce que le monde contemporain, avec ses défis multiples, planétaires et protéiformes, attend de la recherche ? Qu’elle élève le dialogue international en y incluant pleinement les Sud, qu’elle produise plus de connaissances qui nourrissent les innovations répondant à nos besoins sociétaux, et que les savoirs produits irriguent le débat public et la décision politique.
La science ouverte est la clé de ces 3 ambitions. Elle permet de rétablir une égalité d’accès aux résultats de la recherche au sein de la communauté scientifique afin que chaque laboratoire, chaque établissement, où qu’il soit situé dans le monde, puisse contribuer pleinement à la production de connaissances nouvelles. Ce faisant, elle favorise l’excellence scientifique en offrant aux travaux des chercheurs une audience beaucoup plus large : davantage lu, cité, commenté, un article aura plus de chance d’être critiqué, amélioré et apparié avec d’autres résultats et bien sûr les résultats correspondants d’être utilisés.
Enfin, la science ouverte élargit le lectorat de la recherche bien au-delà de la sphère académique : elle permet aux connaissances de franchir toutes les barrières et de s’offrir aux P.M.E., aux O.N.G., au monde associatif, aux citoyens dans leur ensemble. C’est ainsi que l’on pourra bâtir une société pleinement actrice de son devenir, parce qu’elle n’accueillera plus la déferlante de fausses nouvelles sans discernement, parce qu’elle disposera de repères pour faire ses choix et de matière pour imaginer, créer, innover. La science ouverte constitue en effet une magnifique opportunité pour croiser les savoirs et stimuler la sérendipité, mère de nombreuses découvertes.
Provoquer encore et toujours plus ces télescopages, promet de belles avancées scientifiques et de nombreuses innovations technologiques et sociétales, partout dans le monde.
C’est cette stratégie scientifique, cette démarche d’innovation, cette politique publique que je veux accompagner grâce au plan national sur la science ouverte. Il poursuit un objectif très ambitieux : 100 % des articles, des ouvrages, mais aussi, dans le respect de la réglementation, des données, issus des recherches financées par appel à projets sur fonds publics devront être diffusés en accès ouvert. La logique sous-jacente est très claire : tout ce qui a été financé par la collectivité doit revenir à la collectivité. La science est un bien commun qui doit être accessible à tous. L’A.N.R. mettra en place cette obligation pour tous les projets notifiés en 2019. Je me réjouis également que les établissements de la CURIF se soient dotés d’un plan science ouverte qui généralise l’accès ouvert aux publications de leurs enseignants-chercheurs.
Bien sûr il ne s’agit pas de se bercer de grands principes et de se contenter de caresser ce rêve humaniste en négligeant les contraintes, notamment matérielles, qui sont bien réelles. La science ouverte n’est pas une idée éthérée, une utopie hors sol et hors contingences. Elle est bien souvent une affaire de services numériques du 21e siècle, donc une affaire de coordination et de modèle économique.
J’ai vu quelques posters qui accompagnent ces journées. Ils sont représentatifs de la diversité et de la vivacité des propositions, des initiatives, des solutions qui sont mises à notre disposition. J’en retiens que nous sommes dans une phase extrêmement intense d’invention des “règles du jeu” de la science ouverte.
Au premier rang de celles-ci figure la construction d’un nouveau modèle économique de l’édition scientifique. Voilà qui me ramène à la phrase de Stewart Brand que je vais cette fois citer dans son intégralité : "D'un côté, l'information veut être chère, car elle est très précieuse. L'information adéquate dans le lieu approprié change simplement votre vie. D'un autre côté, l'information veut être libre, parce que le coût de son accessibilité est de moins en moins important avec le temps. Ainsi, on a ces deux conceptions qui s'opposent l'une à l'autre". C’est cette tension que la science ouverte doit désormais résoudre.
Au préalable, il nous faut éclaircir un malentendu, car bien souvent ce sont des stéréotypes et des idées reçues qui freinent le déploiement de la science ouverte. La science ouverte n’est pas une science gratuite et ne peut pas l’être. S’il est essentiel que le coût n’en soit pas supporté par le lecteur et que l’usage soit ouvert, il n’en demeure pas moins que les publications scientifiques ont un coût qui doit être structurellement couvert.
La science ne peut pas se passer de l’édition qui a une valeur ajoutée scientifique par son regard critique mais elle ne peut pas non plus étouffer sous son poids ni rester enfermée derrière ses péages prohibitifs. Pour sortir de cette impasse, il nous faut construire un nouveau paysage éditorial, plus équilibré et plus diversifié : les grands éditeurs y auront toujours leur place, à condition que leurs tarifs reflètent davantage les coûts réels, et des solutions éditoriales innovantes devront pouvoir se développer à leur côté. C’est la raison pour laquelle le plan pour la science ouverte prévoit la création d’un fonds dédié à l’édition scientifique ouverte. Il sera alimenté par le fruit des négociations que nous menons actuellement avec les éditeurs dont les tarifs sont excessifs. Ce fonds sera piloté par le Comité de la science ouverte auquel les présidences des grands établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche ont accepté de participer, sous l’égide du directeur général de la recherche et de l’innovation, Bernard Larrouturou. Ce comité prendra, de façon transparente et ouverte, les décisions sur l’utilisation de ce fonds.
Je pense qu’il est essentiel qu’il puisse soutenir des modèles éditoriaux durables et viables sur le plan mondial.
Vous le savez, dans une partie du monde de l’édition ouverte, le coût des publications est supporté par les auteurs. Ce mécanisme de financement n’est pas majoritaire aujourd’hui. S’il devenait dominant, il pourrait avoir des conséquences importantes en termes de géopolitique des sciences. Je ne suis pas sûre que déplacer de façon systématique la barrière, du lecteur à l’auteur, soit vertueux. Le P.D.G. de l’I.R.D. ne cesse de me rappeler que ce modèle est dangereux pour nos coopérations internationales avec les chercheurs du Sud. Certaines disciplines indiquent aussi qu’il n’est ni souhaitable ni possible dans leur communauté. C’est la raison pour laquelle, sans exclure par principe ce mécanisme, je souhaite qu’une diversité de modèles économiques se développe, afin d’assurer une bonne résilience du système, et une bonne adaptation à la pluralité des situations.
J’observe à cet égard avec beaucoup d’intérêt le développement de SCOSS (Global Sustainability Coalition for Open Science Services), initié par Sparc Europe en 2017. Le principe de ce dispositif est de proposer chaque année à des services non commerciaux considérés comme des infrastructures essentielles de la science ouverte dans le monde, de soumissionner pour un financement mutualisé ; les candidatures sont examinées en fonction d’une série de critères tels que la valeur ajoutée pour les différents acteurs de la recherche, la gouvernance, le coût et la durabilité du financement, les projets de développement. Nous avons là les propositions opérationnelles de mutualisation des coûts des services dont nous avons besoin. Je souhaite que la France y participe, de la façon la plus active possible jusqu’à, éventuellement, adhérer à l’organisation elle-même. En effet je suis animée par la conviction qu’il n’y aura pas de solution franco-française à la question de la science ouverte et c’est aussi une des raisons qui fait que j’ai soutenu depuis le début le plan S.
D’autant plus que le défi de la science ouverte ne se limite pas aux publications, loin de là. Cela reviendrait à réduire la science à ses conclusions, alors que celles-ci tirent toute leur valeur de la démarche qui les a produites. Partager la science, c’est donc aussi partager toutes les étapes du processus scientifique, les données et les traitements logiciels qui ont pu leur être appliqués. Les données et les codes source forment un terreau de découvertes et d’innovation que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger.
C’est une clé de la compétitivité future de notre recherche sur laquelle nous ne portons encore pas assez notre attention en dépit de remarquables initiatives.
Si nous voulons exploiter pleinement ce matériau scientifique, il nous faut mieux le conserver, mieux le structurer et mieux le partager, dans le respect de la vie privée et des secrets professionnels, industriels et commerciaux. C’est dans cette perspective qu’un appel flash de l’A.N.R., doté d’1,5 million d’euros, sera lancé début 2019 afin de faire diffuser les pratiques largement au-delà des communautés déjà mobilisées, d’accélérer la structuration, la citation et l’ouverture des données de la recherche des équipes françaises.
Ne nous méprenons pas : toutes ces questions, en dépit de leur entrée technique, ont un impact sociétal majeur.
La découverte du trou dans la couche d’ozone en donne un exemple éloquent. A partir des années 1970, Joseph Charles Farman enregistre à l’aide d’un spectrophotomètre Dobson et de ballons-sondes la concentration d’ozone en Antarctique. Il détecte en 1980 une baisse significative de cette concentration. Il compare avec les données des satellites de la NASA, qui ne révèlent aucune anomalie. Il pense dans un premier temps que son instrument est défectueux. Mais un nouvel instrument fournit des mesures similaires en 1984. La NASA a reconnu par la suite que ses satellites avaient bien identifié le trou mais que leur système de traitement des données avait rejeté ces valeurs anormales... Et cela a pu être confirmé par le retour aux données originales, non retraitées par un algorithme de nettoyage qui s’est révélé a posteriori animé d’un zèle délétère... Le paradigme de la science ouverte aurait sans doute pu épargner ces quatre années de décalage. Vous connaissez la suite, avec l’adoption en 1987 du protocole de Montréal destiné à réduire l’usage des substances chimiques appauvrissant la couche d’ozone. Cette histoire nous invite à une question “ouverte” : à côté de combien de trous dans la couche d’ozone sommes-nous passés en ne partageant pas nos données ?
L’heure n’est plus à refaire l’histoire mais bien à inventer un nouveau monde, où la libre circulation des connaissances sera devenue la norme. Je tiens à vous remercier chacun de contribuer, par votre engagement, par vos débats, par vos échanges de bonnes pratiques, à ce projet scientifique qui est aussi et surtout un projet de société.