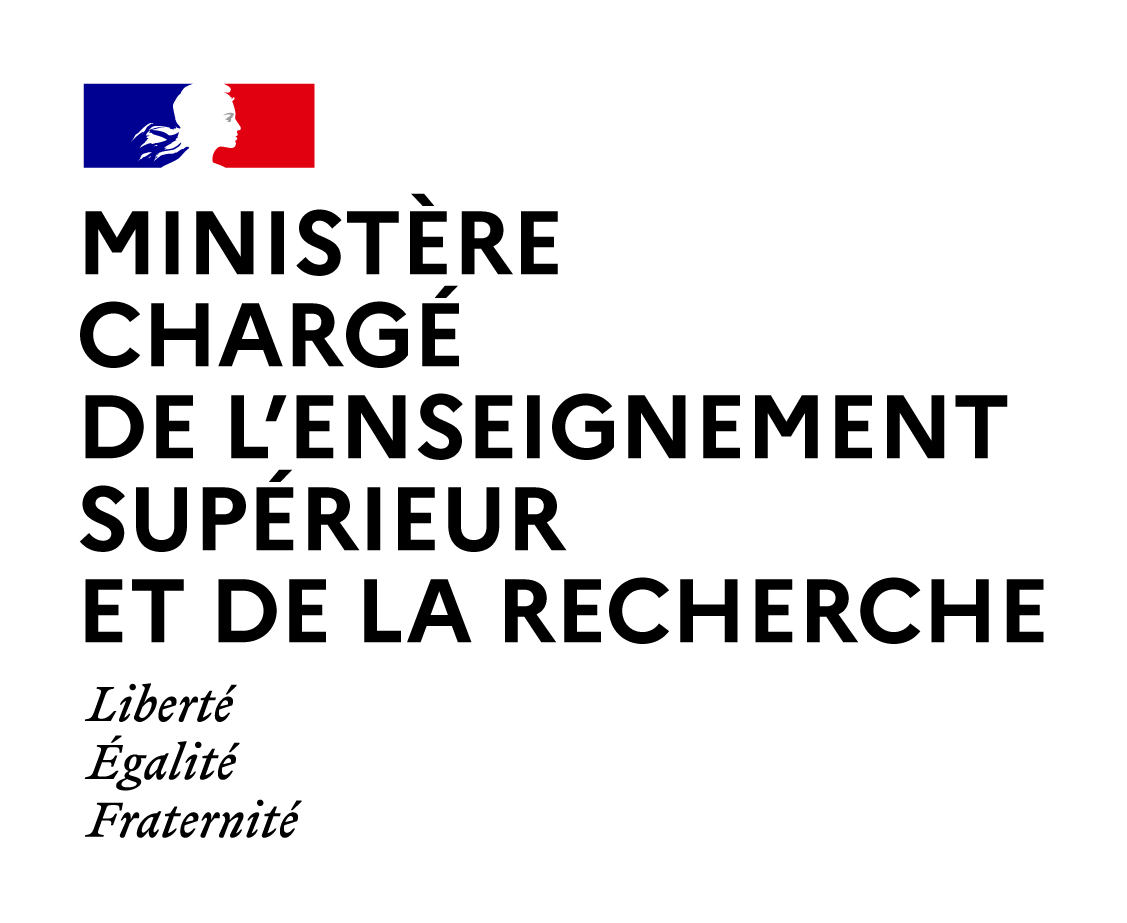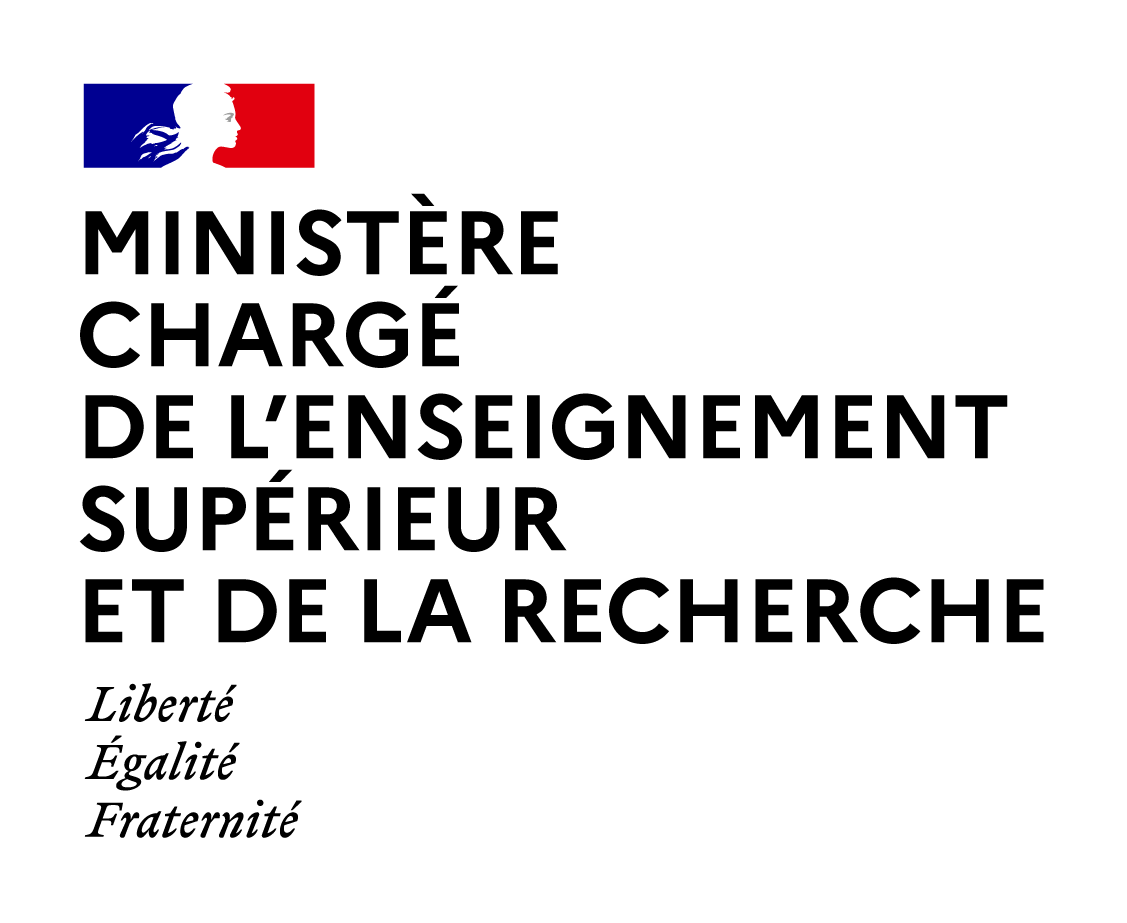L'exposition Mille & une Orchidées du Muséum national d'Histoire naturelle a lieu dans la serre des forêts tropicales humides, du 6 février au 10 mars 2025. Elle propose une scénographie végétale haute en couleurs, avec des orchidées épiphytes, des décors floraux, mais aussi une exposition photographique, la présence d'associations d’orchidophilie, des animations…
Pourquoi sont-elles menacées ?
Certaines espèces d'orchidées sont menacées pour plusieurs raisons :
- les cueillettes excessives dans les milieux naturels ;
- la destruction de leurs habitats (forêts tropicales, zones humides, pelouses calcicoles...) ;
- le déclin de leurs pollinisateurs (insectes, oiseaux, chauves-souris) ;
- le réchauffement climatique ;
- l'urbanisation ;
- la destruction des forêts ;
- la pollution des sols ;
- les incendies, liés à la sécheresse.
Quel est le rôle des chercheurs ?
Description
Les chercheurs interviennent particulièrement dans la connaissance des espèces, car mieux les connaître, c'est proposer des mesures de protection les plus appropriées possible.
Connaître une espèce demande des spécialisations dans plusieurs domaines, à travers leur description, leur classification, l’étude de leur répartition géographique, de leur biologie de reproduction...
La taxonomie, plus précisément, permet d'identifier et de classifier les espèces, pour informer et alerter si besoin sur leur évolution.
La phytogéographie, c'est-à-dire l'étude de la répartition des végétaux à la surface de la Terre, permet quant à elle de mieux comprendre leur évolution et leur adaptation face aux changements globaux.
Multiplication
Certains chercheurs effectuent des travaux de multiplication végétative, principalement grâce à la technique de culture in vitro. Cette technique permet de régénérer une plante à partir de ses cellules ou tissus végétaux. Elle est souvent utilisée pour la sauvegarde des espèces endémiques menacées, des espèces qui ne poussent que dans une région géographique déterminée.
Conservation
Dans les jardins botaniques, on fait ce qu’on appelle de la conservation ex situ, c'est-à-dire qu’on conserve des espèces et des taxons en dehors de leur milieu naturel. Pour des espèces qui sont menacées parce que leur milieu de vie est en danger, le fait de les conserver dans des jardins botaniques permet de préserver la ressource.
Sensibilisation
Les chercheurs font aussi un travail de sensibilisation, comme ici par exemple, à travers une exposition qui s'adresse au grand public.
Vulgariser et diffuser l’information, donc la connaissance, participe à leur protection.
D'autres actions permettent de sensibiliser le public mais aussi les décideurs, comme la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Elle établit, à un niveau mondial, le degré de menaces qui pèsent sur l'ensemble des espèces. Ces indications permettent, en plus de sensibiliser, de suivre l'évolution des populations ciblées et proposer des solutions prioritaires pour protéger la biodiversité.
Voir la liste rouge des orchidées
Rencontre avec les spécialistes, au cœur de l'exposition...
Qu'en pense le botaniste Serge Muller ?
Serge Muller est botaniste, professeur émérite du Muséum national d'Histoire naturelle, expert de la commission "sauvegarde des espèces" de l'UICN et ancien président du Conseil national de la protection de la nature.
Quelles sont les espèces les plus menacées ?
L’UICN distingue trois niveaux croissants de statut de menace : les espèces vulnérables (VU), les espèces en danger d’extinction (EN) et les espèces en danger critique d’extinction (CR), auxquelles s’ajoutent les espèces éteintes au niveau régional (RE) et au niveau mondial (EW). Pour la métropole, une espèce est classée RE (c’est l'Anacamptis collina), 4 EN et 23 VU, alors que pour l’île de La Réunion, il y a 1 espèce EW (c’est l'Angraecum palmiforme), 1 RE, 28 espèces CR, 22 EN et 36 VU, soit une proportion beaucoup plus importante d’espèces en danger et en danger critique d’extinction.
Y a-t-il eu une évolution ces dernières années ?
Des protections ont heureusement été mises en place, d’abord concernant leur commerce dans le cadre de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), puisque les espèces d’orchidées les plus menacées figurent à l’annexe I (commerce interdit) et toutes les autres à l’annexe II (commerce assujetti à autorisation). Ensuite, les espèces les plus menacées sont légalement protégées par les États (par exemple 18 espèces en France métropolitaine, auxquelles s’ajoutent des espèces protégées dans certaines régions, et 38 à l’île de La Réunion). Des sites abritant des orchidées rares et menacées bénéficient en outre de mesures de protection réglementaire (parcs nationaux, réserves naturelles…). Mais malgré ces diverses mesures de protection, la destruction de leurs habitats reste la menace principale sur ces espèces.
Que faut-il faire pour les protéger ?
Pour les protéger, il faut d’abord interdire leurs prélèvements dans la nature et lutter contre leur commerce illégal, mais également protéger leurs habitats, que ce soient les forêts tropicales, les marais et autres zones humides, ainsi que les pelouses calcicoles. Dans certains cas, en particulier pour les espèces inféodées aux prairies et aux pelouses créées depuis des siècles pour l’alimentation des animaux domestiques, des modes de gestion conservatoire (pâturage extensif ou fauche sans fertilisation) doivent être mis en place.
Quel est le rôle du Muséum ?
Le Muséum intervient d’abord dans la connaissance taxonomique des espèces d’orchidées (comme pour toutes les autres espèces) et ceci grâce également aux nombreux spécimens conservés dans l’Herbier du Muséum. A partir de cette connaissance des espèces, de leur répartition, de leur biologie et écologie, les botanistes du Muséum contribuent à l’évaluation des menaces et à leur inscription sur les listes rouges nationales et la liste rouge mondiale d’espèces menacées, en vue d’assurer leur protection règlementaire et de créer des zones protégées.